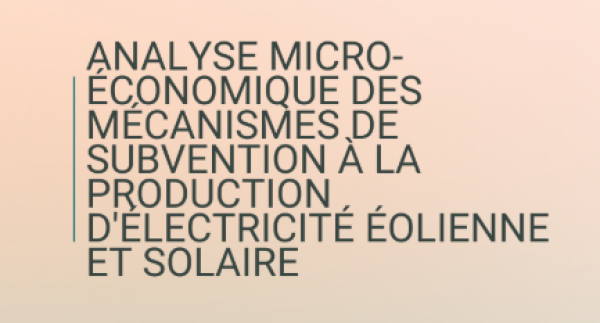
Le déploiement des énergies renouvelables intermittentes est soutenu par les pouvoirs publics de nombreux pays, particulièrement en Europe, via des mécanismes de subvention à la production, souvent sous la forme de contrats de subventions accordés par appels d’offres.
Contexte & enjeux
Les systèmes de subvention à la production d'électricité renouvelable, éolienne et solaire en particulier, présentent une grande diversité (selon le pays, la période...). Dès l’or, les incitations et les risques auxquels sont exposés les producteurs d'électricité renouvelable varient également, ce qui se répercute sur l'efficacité de ces subventions, et appelle donc une réflexion sur la conception de ces politiques publiques. Pour alimenter cette dernière, cette thèse développe une analyse microéconomique de différents dispositifs en s’appuyant sur la théorie des contrats et des enchères, en intégrant le contexte dans lequel ils sont mis en place (ressources en vent et en soleil, dynamiques du marché de l’électricité, contexte macroéconomique...).
Objectifs
Pour d'accompagner la transition du secteur électrique vers des sources d'énergies renouvelables, de nombreux gouvernements les subventionnent afin de rendre rentable ces technologies, encore trop coûteuses en l’absence d'intervention publique. Le soutien à la production (c’est-à-dire le versement subventions en fonction de la quantité d'électricité produite) est le mode de soutien le plus courant dans le cas des technologies matures, telles que le solaire photovoltaïque et l’éolien. Cependant, les règles des contrats de subventions ou la manière dont est déterminé le niveau de ces subventions varient largement d’un dispositif à l’autre.
Incitations, concurrence et risques pour les entreprises
Leur conception vise maximiser l'efficacité de ce soutien et à en limiter le coût public. Par exemple, en exposant les producteurs aux signaux prix des marchés de l'électricité, les systèmes de compléments de rémunération favorisent les projets susceptibles de produire de l'électricité lorsque le prix de marché l'électricité est le plus élevé.
De même, la sélection des projets par appels d’offre permet une mise en concurrence des projets et fixe le niveau de subvention par des enchères, pour en limiter le coût public. Cependant, ces dispositifs exposent les producteurs et porteurs de projets éoliens et solaire à plus de risque : au risque météo (soleil et vent) viennent s’ajouter la volatilité du prix de marché de l'électricité (amenée à croître avec la part d'énergies intermittentes dans le mix électrique) et l’issue des appels d'offre (risque de non-sélection).
Or ces risques accrus sont de nature à évincer une partie des projets, ou à inciter les porteurs de projets à demander des subventions plus importantes lors des enchères. La modélisation microéconomique du comportement des entreprises face à divers dispositifs de subventions permet d'évaluer l'impact de ces risques accrus sur l'efficacité de ces dispositifs.
Résultats attendus
Minimisation des risques et failles des dispositifs
Les gouvernements ayant conscience des conséquences en termes de coût public d’un risque trop grand supporté par les producteurs, des dispositions sont souvent prises afin d’assurer les entreprises face au risque de baisse des prix de l’électricité, de baisse de la production due aux conditions météorologiques ou encore du risque d'inflation. Ces dispositions entraînent une complexification des contrats de subvention et des règles d’appels d'offres, complexité propice à l'apparition de failles qui permettraient aux entreprises d'adopter des comportements stratégiques.
Ces comportements stratégiques, non anticipés par le décideur public, seraient profitables aux entreprises qui les adoptent mais ruineraient l'efficacité globale du dispositif (par exemple en attribuant des subventions à des projets peu efficaces). Identifier de telles failles dans des dispositifs existants et en évaluer les conséquences constituent un autre aspect de cette thèse.
Laboratoire d'accueil
- École doctorale Ville, Transports et Territoires
Cofinanceur
- Centre international de recherche sur l'environnement et le développement
Localisation du terrain d'étude
- Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne
Détails du projet
- Date de début : Date de début : Janvier 2019
- Durée : 36 mois
Encadrement de la thèse
- Thèse co-financée par l'ADEME et École doctorale Ville, Transports et Territoires
- Thèse encadrée par Laurent Lamy et Philippe Quirion


