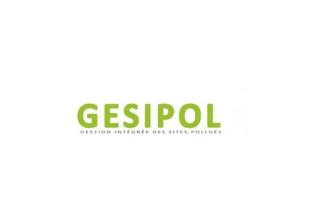Le projet en deux mots
La réhabilitation des sols industriels nécessite une estimation précise des concentrations de polluants, particulièrement en cas de fortes variations, pour améliorer les diagnostics et réduire les coûts et risques de dépollution. Le projet vise à adapter et évaluer des méthodes géostatistiques, notamment l'écrêtage des valeurs extrêmes, pour améliorer ces estimations et fournir des guides pratiques aux bureaux d'études.
Contexte et enjeux
La réhabilitation des sols d’anciens sites industriels est un enjeu majeur de la gestion urbaine, du fait de leur nombre et de leur superficie cumulée (environ 100 000 ha). Ces sites sont généralement localisés en milieu urbain ou périurbain, où une forte pression foncière s'exerce. La valeur d'usage des sols dépend de leur état, notamment de leur concentration en différents polluants. L'estimation précise des concentrations, et notamment des zones dans lesquelles celles-ci dépassent une valeur-seuil fixée, est donc essentielle pour améliorer le diagnostic des sites et évaluer avec précision l'exposition des populations ou le transfert (évaluation du terme source).
L'intérêt de la géostatistique pour l'estimation des concentrations et l'évaluation des incertitudes associées est désormais reconnue par la profession, comme le prouve le développement des bureaux d'étude disposant d'une compétence en géostatistique. Mais ces bureaux d'études rencontrent des difficultés pratiques pour la mise en oeuvre des méthodes géostatistiques (variographie et krigeage) lorsque les concentrations apparaissent fortement contrastées ou s'étendent sur plusieurs ordres de grandeurs, comme c'est notamment le cas des pollutions organiques. Par ailleurs, la mise en oeuvre des estimateurs géostatistiques non linéaires, nécessaires pour tenir compte des incertitudes dans la délimitation des zones polluées (en référence à une valeur-seuil et à un "support" fixés) reste encore l'affaire de spécialistes. Des méthodes plus simples, mais adaptées au contexte des concentrations contrastées sont donc nécessaires.
En présence de concentrations fortement contrastées, la pratique habituelle des bureaux d'étude consiste à "rabattre" les valeurs les plus fortes, afin de stabiliser le variogramme et d'éviter des artefacts visibles sur les cartes de concentrations estimées. Mais cet "écrêtage" des plus fortes concentrations manque de fondements conceptuels, et induit des biais sur l'estimation du fait de la disparition des concentrations les plus fortes. Des travaux récents (Rivoirard et al., 2013) ont donné un sens à cette pratique empirique ainsi qu'au choix de la valeur d'écrêtage, en la rationalisant. Il s'agit maintenant d'adapter et d'évaluer cette nouvelle modélisation dans le cas de la pollution des sols, puis de donner des guides pour sa mise en oeuvre pratique.
Le projet vise donc à améliorer les méthodes d'estimation en présence de forts contrastes de concentrations.
Le projet s'inscrit ainsi dans le contexte de l'acquisition de connaissances par la caractérisation plus poussée de la structure spatiale de différents types de pollutions organiques (COHV, HAP), du développement de nouvelles méthodologies d'estimation géostatistique adaptées aux sites complexes, ainsi que du transfert de compétences vers les bureaux d'étude.
Objectifs
- Mise en oeuvre de la méthode d'écrêtage pour l'estimation de pollutions organiques pour deux sites.
- Evaluation de la méthode et rédaction d'un guide méthodologique.
Synthèse des résultats
Les conséquences d'une meilleure estimation des concentrations sont autant économiques qu'environnementales :
- réduction des coûts consécutifs à des prévisions mises en défaut lors des chantiers de réhabilitation ou à une surévaluation par précaution des volumes pollués,
- réduction du risque d'une dépollution incomplète, meilleure orientation des terres excavées selon leur degré de pollution ;
- amélioration de l'évaluation de l'exposition des populations par une meilleure connaissance du "terme source" (en surface pour les poussières, en profondeur pour le transfert à la nappe) et des incertitudes associées ;
- amélioration de la qualité des travaux des bureaux d'études.
Coordinateur
- ARMINES
Partenaires
- ENVISOL
Début et fin de projet
- Octobre 2015 à Octobre 2017
Montant total projet
- 131 000 euros
Montant de l'aide Ademe
- 92 000 euros